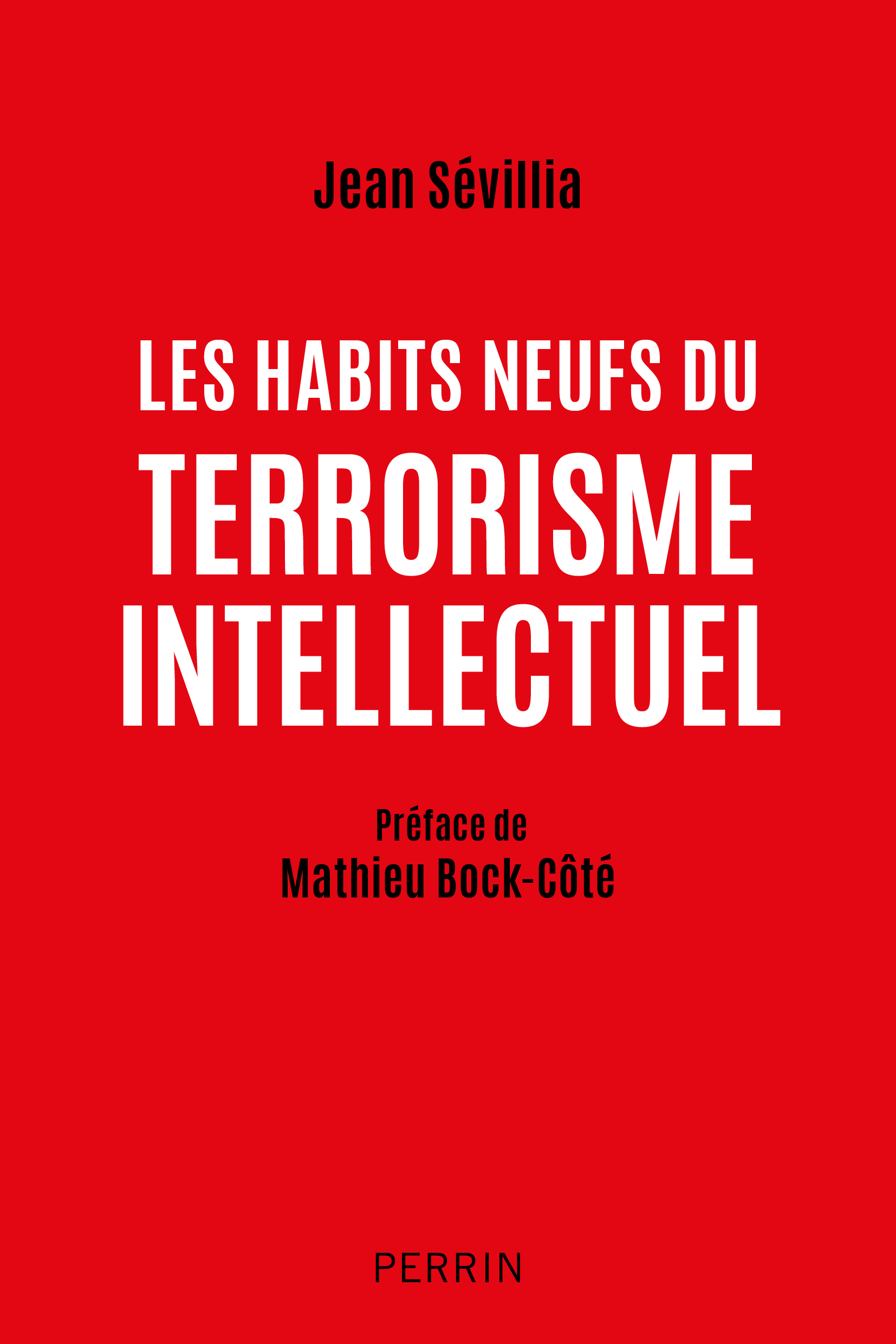Il y a 70 ans, Londres était bombardée. Si la bataille d’Angleterre n’avait pas été remportée, si la po-pulation civile n’avait pas résisté avec hé-roïsme, Hitler aurait gagné la première manche de la guerre.
Le 8 septembre dernier, à Londres, 2 500 anciens pilotes, infirmières, ambulanciers et pompiers étaient réunis à la cathédrale Saint-Paul afin de célébrer le 70e anniversaire du Blitz. Quinze jours plus tard, la station de métro Aldwych, habituellement fermée, était rouverte le temps d’un week-end : dans ce décor à l’ancienne, qui avait servi d’abri pendant la guerre, une vieille rame se tenait à quai, et des acteurs en costume d’époque expliquaient au public comment vivaient les habitants de la capitale au temps des bombardements. Dans les deux cas, il s’agissait de célébrer le fighting spirit (l’esprit de combat) dont firent jadis preuve les Londoniens, esprit qui fait désormais partie du légendaire britannique.
En 1940, après la défaite française, Hitler rêve brièvement d’une paix de compromis avec la Grande-Bretagne. Face au refus de Churchill, il imagine d’envahir le pays par voie maritime, ce qui postule la maîtrise des airs et donc l’élimination de la Royal Air Force. Commencée le 10 juillet, terminée à l’automne, la bataille d’Angleterre sera le premier affrontement entièrement aérien de l’histoire européenne. Côté allemand, il s’agit de détruire l’aviation britannique au sol ou dans le ciel. Côté anglais (mais il n’y a pas que des pilotes anglais pour affronter la Luftwaffe), il importe de briser l’offensive ennemie. En août, la RAF effectue plus de 700 sorties quotidiennes. Mais début septembre, Hitler change d’objectif : espérant casser le moral de la population, il ordonne de bombarder systématiquement les villes britanniques.
Le 7 septembre 1940, une armada de 360 bombardiers allemands, escortée de 600 chasseurs, attaque Londres, de 17 heures à 4 h 30 du matin, en commençant par les quartiers populaires de l’East End : ce raid fera plus de 500 morts et plus d’un millier de blessés. C’est le début d’une guerre qui recevra son nom de la presse anglaise – Blitz est un raccourci de l’allemand Blitzkrieg, « guerre éclair » – et qui durera presque neuf mois. Afin d’échapper à la défense antiaérienne, les assaillants opèrent de nuit. Tous les soirs, plus de 1 000 avions de la Luftwaffe traversent la Manche, par vagues de 150 à 200 appareils, prêts à répandre la mort.
Pendant 57 nuits consécutives, Londres est bombardée, avant que le brouillard n’offre un bref répit aux habitants. Le 11 septembre, le palais de Buckingham est touché ; le 10 octobre, c’est la cathédrale Saint-Paul ; le 8 décembre, ce sera au tour de la Chambre des communes, qui sera détruite plus tard. Mais, à côté de ces monuments nationaux, des milliers de demeures anonymes sont la proie des bombes. A partir du 15 octobre, d’autres grandes villes sont attaquées : Manchester, Birmingham, Glasgow, Plymouth, Liverpool… Dans la nuit du 14 au 15 novembre, Coventry subit un déluge de feu qui détruit aux trois quarts son centre médiéval.
Dans ses Mémoires, Churchill se souvient : part le métro, il n’y avait pas d’abris réellement sûrs. Très peu de sous-sols ou de caves étaient à l’épreuve d’un coup au but. Pratiquement tous les Londoniens devaient vivre et dormir dans leurs maisons ou leurs abris Anderson (1), sous le feu de l’ennemi. Et chacun courait sa chance avec un flegme tout britannique après une dure journée de travail». Le gouvernement anglais, au cours des mois précédents, n’avait pas pris plus de précautions pour protéger les habitants du pays que ses propres services, si bien que les ministères, à commencer par la résidence du Premier ministre, étaient en permanence exposés au danger.
A partir de ces faits, en cette année 2010, certains journaux britanniques ont cherché à lancer une polémique en prétendant montrer ce qui serait la face occultée du Blitz : l’impréparation du pays, les pillages après les bombardements, etc. Spécialiste de l’histoire de l’Angleterre et biographe de Churchill, François Kersaudy ne prend pas ces imputations au sérieux. Ce que j’ai lu ne reposait sur aucune preuve telle que des archives ou des rapports de police,observe-t-il. Au sujet des vols, ce qui s’est certainement passé, c’est que beaucoup de délinquants se sont retrouvés en liberté pendant le Blitz et qu’ils en ont profité, nombre de maisons étant éventrées ou leurs locataires étant absents, mobilisés par la défense passive. J’ai vu aussi un petit article affirmant que des Juifs auraient été refusés dans les abris, mais, là encore, l’accusation ne s’appuyait sur aucune source fiable. Tout cela semble prétexte à des titres à sensation qui font vendre du papier.»
Le 21 mai 1941, un mois avant l’attaque allemande contre l’URSS, le dernier raid sur Birmingham marque la fin du Blitz. Incapable de vaincre la chasse adverse, et ayant constaté que les embarcations destinées à un débarquement de la Wehrmacht en Angleterre étaient coulées au fur et à mesure qu’elles étaient installées dans les ports de la Manche, Hitler avait d’abord dû renoncer à son projet d’invasion. La résistance britannique aura également raison de sa stratégie de bombardement, le Führer réservant ses forces en vue du conflit qu’il préparait en secret contre Staline.
Le nombre de victimes civiles du Blitz approche les 50 000 morts, dont la moitié dans la capitale. Londres, écrit encore Churchill dans ses Mémoires, était comme un gigantesque animal préhistorique, capable de recevoir des coups terribles et de continuer même mutilé, saignant par mille blessures, à bouger et à vivre» (3). Sans la résistance de cet « animal », le sort du monde eût été tragiquement modifié.
Jean Sévillia
(1) Les abris Anderson étaient des abris en tôle qui avaient été distribués à la population, mais dont la taille nécessitait l’installation dans un jardin.
(2) et (3) Mémoires de guerre, 1919-1941, de Winston Churchill, Tallandier, 2009. Le second volume, Mémoires de guerre, 1941-1945, vient de paraître chez Tallandier. Une nouvelle édition, présentée et traduite par François Kersaudy.